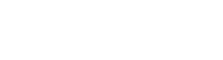Protection des données personnelles
Cette page a pour objet de vous informer de la façon dont la Ville de Grenoble traite vos données personnelles et quels sont vos droits sur les traitements qu'elle effectue.
Traitement de vos données personnelles par la Ville de Grenoble
La Ville de Grenoble traite vos données personnelles dans le respect de la réglementation en vigueur (Loi Informatique et Liberté et RGPD) pour les seules finalités présentées par le traitement ou le formulaire en ligne à destination des élus ou des services municipaux.
Formulaires
Les données des formulaires de contact d'un service, d'appel à participation, d'inscription à une formation ou d'inscription à un événement (conférence, atelier, table ronde…) sont conservées une année, sauf durée différente explicitement mentionnée dans le formulaire. Vos données seront supprimées ou anonymisées au terme de la durée de conservation spécifiée. Aucune copie n'est réalisée ni aucune cession à un tiers.
Vous pouvez néanmoins demander la suppression anticipée de ces données. Voir la rubrique : "Exercer vos droits sur les traitements".
Accueil téléphonique
Les conversations téléphoniques entrantes ne font actuellement pas l'objet d'un enregistrement.
Téléservices
Les données recueillies sur les sites internet de la Ville de Grenoble résultent de la communication volontaire de données à caractère personnel par les visiteurs. Ces données sont communiquées aux services concernés en vue de réaliser les prestations souhaitées par l'usager dans le cadre des téléservices assurés par la Ville de Grenoble et ses établissements.
Conformément à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et au décret n° 2010-112 du 2 février 2010, les téléservices de la Ville de Grenoble qui ont fait l'objet de décisions d'homologation de sécurité sont conformes au référentiel général de sécurité (RGS) approuvé par arrêté ministériel du 13/06/14.
Exercer vos droits sur les traitements
Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, a renforcé vos droits sur le traitement de vos données.
Vous pouvez ainsi pour chaque traitement :
- Demander l'accès à vos données, connaître les données en notre possession vous concernant (droit d'accès).
- Demander la modification de vos données s'il s'avère qu'elles sont inexactes ou incomplètes (droit de rectification).
- Demander l'effacement de vos données lorsque plus rien ne justifie que nous les conservions (droit à la suppression ou droit à l'oubli).
- Demander l'arrêt temporaire d'un traitement de tout ou partie de vos données en cas de litige (droit à la limitation du traitement).
- Vous opposez à un traitement de vos données à des fins de prospection ou pour des raisons tenant à votre situation particulière (droit d'opposition à un traitement), lorsque le traitement se fonde sur une mission d'intérêt public ou l'intérêt légitime de la collectivité.
- Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au traitement de vos données lorsqu'il est requis au préalable.
Pour exercer vos droits, vous devez vous adresser au service responsable et vous avez la possibilité de contacter le délégué à la protection des données de la Ville de Grenoble par mail ou par courrier en écrivant à :
Hôtel de Ville
Délégué à la protection des données
11, boulevard Jean Pain CS 91066
38021 Grenoble Cedex 1
Si après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits "Informatique et libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en écrivant à :
CNIL Service des Plaintes
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Ou faire une réclamation directement en ligne.
Cookies
Qu'est-ce-qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site. Les cookies ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés. Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Quels sont les cookies utilisés sur ce site ?
Statistiques
Le site de la Ville de Grenoble utilise Matomo pour collecter des statistiques anonymes sur son utilisation par les internautes (pages consultées, nombre de visiteurs, navigateurs utilisés...). Ces données nous permettent d'améliorer votre accès aux informations.
Des cookies Matomo sont déposés sur votre ordinateur.
Contenus enrichis
Le site de la Ville de Grenoble utilise des services dédiés pour vous proposer des contenus enrichis.
- Pour la diffusion de vidéo, la Ville de Grenoble utilise les solutions de YouTube, Daily Motion et Viméo.
- Pour la publication de documents interactifs, la Ville de Grenoble utilise les services de Calaméo.
La lecture de ces contenus enrichis nécessite le dépôt de cookies.
Durée de validité du consentement à la dépose des cookies
A l'issue d'une période de treize mois à compter de la première visite du site, une demande de consentement à la dépose de cookies sur son terminal est renouvelée auprès du visiteur.