Surplombant la Porte de France, le Rabot a connu plusieurs destins. Son plus vieux vestige, et aussi le plus emblématique, reste la tour Rabot qui date de la fin du Moyen Âge, une époque où les pâturages et la viticulture y prenaient toute leur place. L’humain s’aventurait peu sur ces pentes.
À partir du début du XIXe siècle, le lieu a peu à peu été transformé en une véritable cité militaire. Une trentaine d’années de travaux seront nécessaires pour bâtir une citadelle faite de pierres extraites sur place ou provenant de carrières plus lointaines, comme celles de Sassenage ou de Voreppe.
Le Rabot, la Bastille et le reste de la ville
L’objectif était de construire une place forte en hauteur, avec ses enceintes et ses casernes, pour préserver la ville basse grâce au feu de l’artillerie. En même temps, cette partie dominante devait aussi pouvoir être défendue par les fortifications de la plaine, elles-mêmes en cours de reconstruction et d’élargissement
, raconte l’historien Denis Cœur, coauteur du diagnostic patrimonial du Rabot commandé par la Ville de Grenoble.
Cela fait partie de l’identité de Grenoble que de réfléchir à la place de la montagne dans la ville ou d’une ville à la montagne. Jusqu’en 1820, nous avons vécu avec l’héritage de Lesdiguières. Même si elle était très présente, c’était une montagne encore largement hors de la ville.
L’artillerie a ensuite investi le site pendant une centaine d’années, insufflant une vraie vie dans ce haut lieu. Puis la déprise militaire a débuté à partir des années 1880 et la montagne s’est peu à peu vidée de ses hommes.
Vers de nouveaux usages
Dans les années 1930, le tourisme s’est installé non loin, en haut du site de la Bastille, avec l’arrivée du téléphérique. Le Rabot devra quant à lui attendre les années 1960 et le projet universitaire pour voir apparaître une autre forme de vie. Un nouveau rapport montagne - plaine s’installe
. Les bâtiments Chartreuse, Vercors et Belledonne viennent compléter les bâtiments militaires et la tour Rabot, imposant une nouvelle architecture.
Ce lieu a un nouveau sens, mais c’est une vie qui reste relativement marginale. Il reste clos sur lui-même. L’accès au site constitue un enjeu important, d’abord du fait de la géographie, mais aussi en lien avec l’héritage défensif du site.
Tout au long de son histoire, le Rabot a été territoire de projets et en projet.
Alors que le moment universitaire prendra fin cet automne, quelle relation ville basse - montagne souhaitons-nous à l’avenir ? C’est à cette question d’un nouvel avenir que l’étude programmatique portée par la Ville de Grenoble en 2024 par l’équipe GRAB (Grenoble Rabot Bastille) a tenté de répondre. Au regard des héritages militaires et universitaires, de la dimension culturelle des lieux à laquelle participe le Musée dauphinois tout proche, penser le devenir de ce lieu est à la fois un défi et une chance pour la ville.
Informations complémentaires
Durée
Pour aller plus loin, l’exposition Bastille inédite, Rabot insolite est à découvrir à la Plateforme du 12 mars au 26 juillet.
à lire en complément
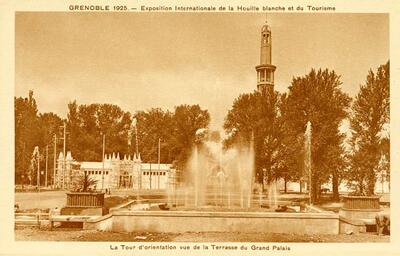
Patrimoine et Histoire




