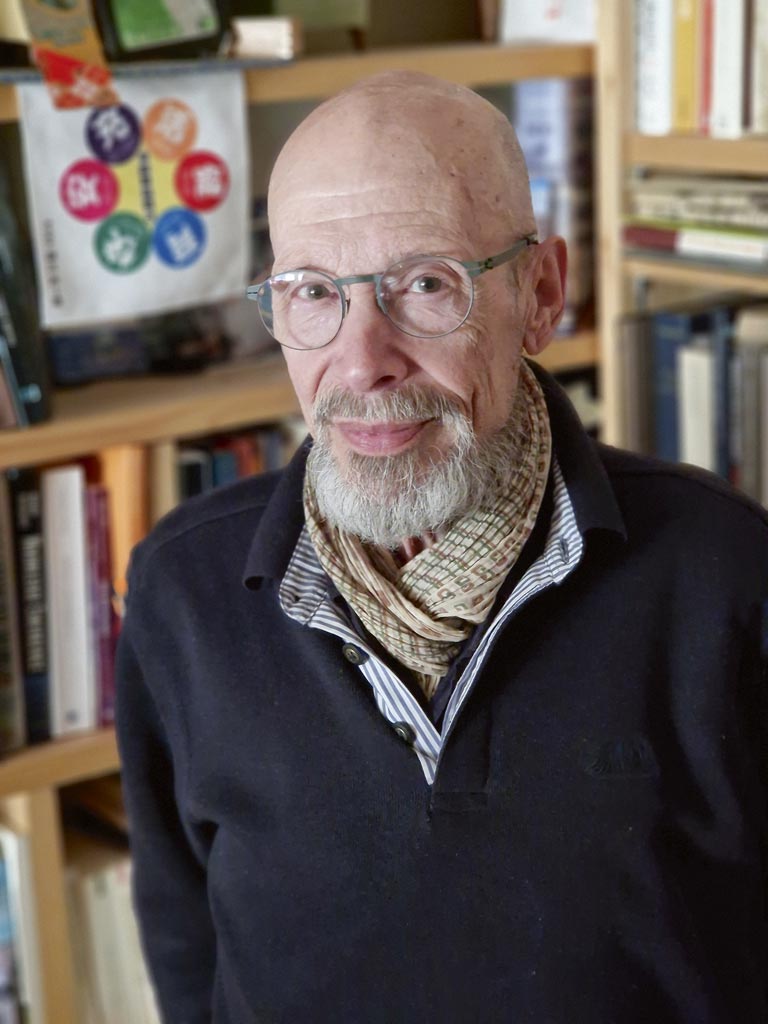Pourquoi faire la promotion de la gratuité ?
Promouvoir la gratuité, c’est résister à l’extension de l’esprit du capitalisme qui menace la société de délitement. Cet esprit transforme en effet toute relation en relation marchandise et réduit la société à une économie de marché. Heureusement cet esprit est absent de la plupart de nos relations interindividuelles quotidiennes. Nous échangeons des « services », nous nous prêtons des objets, nous partageons des légumes de notre jardin ou de notre balcon, des parts du gâteau qu’on a confectionné. Nous donnons un coup de main pour déménager, pour garder un enfant ou un parent et tous ces actes gratuits nous rendent la vie plus agréable et font du bien tant à la personne qui reçoit qu’à celle qui donne. Élargir ces gratuités de la famille au voisinage, au quartier, à la ville, c’est vivre ensemble de manière plus conviviale et solidaire. Cela n’a pas de prix, c’est inestimable.
Où en est-on dans les villes françaises ?
Les villes françaises comme toutes les communes ont de tout temps offert du « commun », gratuit, à leurs habitant-es. En revanche les services de distribution d’eau potable, l’assainissement sont payés par les usagers et les usagères. Mais il y a des équipements dont l’accès tend à devenir au moins partiellement gratuit, parfois en fonction du revenu : des bibliothèques, des musées, des conservatoires, des centres aérés. Des équipements sportifs et culturels gérés par des associations subventionnées sont aussi accessibles, si ce n’est gratuitement, à des tarifs très bas.
Dans beaucoup de villes un effort est fait pour aller vers la gratuité totale de l’accès à plusieurs de ces équipements d’abord au bénéfice des moins aisé-es. Toutefois, dans la plupart des 650 communes de plus de 50 000 habitant-es en France, la gratuité reste limitée.
Jusqu’où peut-on rendre gratuits les services ?
Décider de la gratuité d’un service fourni pose au moins deux questions. La première est de savoir comment couvrir les coûts de fourniture. Le bénévolat ne suffit pas. Il faut donc puiser dans les impôts payés par les citoyen-nes et les entreprises. Si le service concerné bénéficie potentiellement à toutes et tous de manière égale, la gratuité ne pose pas de problème : tout le monde peut se promener dans un parc par exemple.
La gratuité peut être différenciée pour plus de justice sociale : mettre des tarifs en raison d’une référence de revenu pour permettre à des personnes moins aisées de visiter un musée, de couvrir leurs besoins de base en eau ou en électricité par exemple.
Deuxième question : comment faire accepter que l’impôt payé par toutes et tous serve à fournir un service ne bénéficiant qu’à une seule catégorie ? Si je ne prends ni le tram ni le bus pourquoi dois-je payer pour ceux qui l’utilisent ? Cet exemple renvoie entre autres à la conception de l’intérêt général. La gratuité des musées popularise la culture, celle des trams peut inciter à les utiliser, ce qui contribuera à réduire l’empreinte carbone et la congestion de la circulation automobile.
Comment plaider pour la gratuité ?
Faire place à la gratuité en ville, c’est redonner toute sa place aux communs et à une vie digne pour tous les membres de la commune. Ce n’est pas ignorer que nombre de communs ont un coût au moins pour leur entretien ou pour les rendre disponibles, mais cette gratuité totale ou partielle doit être pensée pour que personne ne soit exclu de l’accès à ces communs et à ces services publics, contre son gré. Il faut aussi veiller à ce que ne s’y substituent pas des services privés marchandisés selon l’esprit capitaliste. Non seulement ils créeraient de l’exclusion mais ils seraient rendus dans une logique incompatible avec des vies dignes et avec le soin que nous devons à la Nature. Préférons les services publics et étendons leur gratuité.
à lire en complément

Solidarités